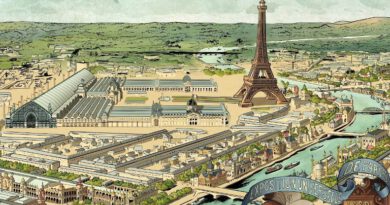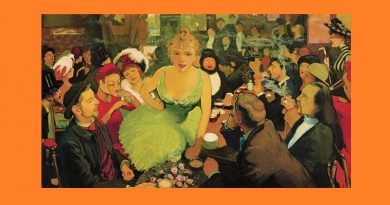Le cheval
La domestication du cheval par l’homme remonte à près de six mille ans. En vivant ainsi à ses côtés, l’homme a appris au cours des siècles à analyser ses comportements omme.
Lorsque l’on évoque Chantilly, les gourmets pensent bien évidemment à la délicieuse crème créée en 1671 par François Vatel pour la réception donnée en l’honneur de Louis XIV dans le célèbre château. En 1719, Louis-Henri de Bourbon, prince de Condé, chasseur passionné, décide de construire des écuries monumentales pour abriter ses chevaux de chasse. L’architecte Jean Haubert, élève de Mansart, conçoit un projet ambitieux qui doit s’imposer comme un véritable palais dédié aux chevaux. Pouvant accueillir à cette époque deux cent quarante chevaux, les Grandes Ecuries impressionnent par leurs dimensions : 186 m de long, un dôme majestueux de 28 m de hauteur et des nefs latérales. Cet extraordinaire complexe avec son architecture entièrement en pierre de taille, son abondant décor sculpté et ses aménagements intérieurs constitue sans doute, après Versailles, le plus beau monument dédié au cheval.
Sous la Révolution, les Grandes Ecuries réussissent à échapper à la destruction et sont alors converties en casernes militaires jusqu’au premier Empire avant d’être rendues aux Condé en 1814 puis léguées aux Orléans de 1830 à 1848. Un champ de courses est aménagé en 1834 qui accueille encore aujourd’hui des réunions aussi prestigieuses que le prix du Jockey Club (1836) ou le Prix de Diane (1843). La IIIe République restitue le domaine de près de huit mille hectares au duc d’Aumale (cinquième fils de Louis-Philippe) qui en fait don à l’Institut de France à son décès en 1897. Après la Seconde Guerre mondiale, les Grandes Ecuries deviennent une école d’éducation équestre et le lieu de dressage et d’entraînement du cercle hippique de Chantilly.
Le Musée vivant du Cheval est créé en 1982. Il constitue une collection d’objets autour du cheval, les métiers, la pratique de l’équitation ou encore l’histoire équestre et hippique de Chantilly. Véritable institution reconnue pour le sérieux et la qualité de son équitation, la Compagnie équestre à l’uniforme rouge et noir se caractérise par sa recherche de l’excellence, son souci du détail et l’originalité de ses créations. Elle présente chaque année trois grands spectacles sur la piste de sable du majestueux dôme sous lequel ont été aménagés des gradins pouvant accueillir six cents personnes.
Les Grandes Ecuries de Chantilly sont l’un des sites équestres les plus visités au monde ; communauté vouée à l’amour du cheval et du spectacle, elles sont inscrites depuis novembre 2011 au patrimoine Immatériel de l’UNESCO.
Saumur
 Autre ville équestre réputée : Saumur qui fête cette année le bicentenaire de la prestigieuse école du Cadre noir. Sa dénomination est une référence à la couleur des uniformes noirs des instructeurs au célèbre bicorne, dans une volonté de contraste avec les officiers en charge de l’enseignement militaire vêtus de bleu et coiffés d’un képi.
Autre ville équestre réputée : Saumur qui fête cette année le bicentenaire de la prestigieuse école du Cadre noir. Sa dénomination est une référence à la couleur des uniformes noirs des instructeurs au célèbre bicorne, dans une volonté de contraste avec les officiers en charge de l’enseignement militaire vêtus de bleu et coiffés d’un képi.
Sous la Renaissance, le raffinement des cours princières italiennes est à son apogée. Outre les fêtes et la danse, l’usage du cheval pour la parade et non plus seulement pour la chasse et la guerre, s’étend dans les cours européennes. A partir des maîtres italiens, les écuyers français enseignent de nouvelles techniques pour monter à cheval et introduisent les ballets de chevaux. A la fin du XVIe siècle, Henri IV fonde à Saumur une université protestante comportant une académie d’équitation. En 1763, Louis XV charge le duc de Choiseul de réorganiser la cavalerie royale en formant les officiers chargés de l’instruction dans les régiments de cavalerie. Liée à l’histoire des monarques et des cours, la cavalerie est décimée au lendemain des guerres napoléoniennes. Charles X décide en 1825 de l’organisation de l’Ecole royale de cavalerie de Saumur.
Au début du XXe siècle, lorsque les chars et l’aviation remplacent progressivement les chevaux sur les champs de bataille, se pose la question de l’utilité du Cadre noir au sein de l’armée. Avec ses plus de trois cents chevaux, l’institution commence également à s’intéresser aux compétitions équestres des Jeux olympiques où ses cavaliers vont peu à peu s’illustrer dans chacune des trois disciplines : dressage, saut d’obstacles et concours complet d’équitation.
Pour ne pas se résoudre à faire disparaître ce qui est devenu au fil du temps un véritable patrimoine vivant pour la France, le gouvernement décide de regrouper civils et militaires. Créé par décret en 1972, le Cadre noir dépend du ministère de la Jeunesse et des Sports et passe ainsi du statut militaire au statut civil. En 2011, l’UNESCO inscrit le Cadre noir de Saumur au patrimoine culturel immatériel de l’humanité : reconnaissance qui honore un art fait de discrétion, de recherche et de complicité entre le cavalier et le cheval avec un souci particulier de l’élégance.
Geneviève Forget