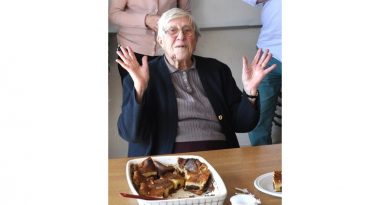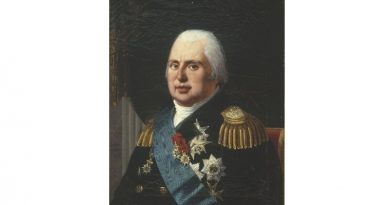Souvenirs d’antan : les lavoirs …
A regarder autour de nous, nombreux sont les villages à posséder un lavoir, petite bâtisse le long d’un cours d’eau qui révèle l’histoire de nos régions. Par le décret du 14 décembre 1789, les communes deviennent gestionnaires de leur budget et responsables de la construction d’équipement améliorant les conditions de vie des citoyens, notamment propreté, salubrité, tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.
Avec la révolution industrielle, l’insalubrité règne. Si la propreté du corps devient un impératif, celle du vêtement l’est tout autant, les épidémies ayant démontré que le linge peut véhiculer des germes malsains. Vers 1850, la deuxième République fait voter une loi pour inciter les communes à créer un espace dédié au lavage du linge. Les villages et hameaux se dotent de constructions spécifiques en bois, pierres, briques ou torchis. Pour être alimenté en eau, le lavoir est bâti au bord d’une rivière, d’un lac, d’une fontaine ou proche d’une source. Il peut être couvert ou à ciel ouvert, protégé par des murs, murets ou complètement ouvert sur l’extérieur. De forme rectangulaire, ovale ou circulaire, il comporte un bassin principal parfois complété par des bacs individuels en pierre pour tremper et rincer le linge. Dans les campagnes, ces édifices témoignent d’une grande variété architecturale selon les régions alors que dans les villes, ils sont bien souvent dans des hangars fermés.
 Autrefois, laver le linge au lavoir prenait beaucoup de temps. La première phase de la lessive se déroulait dans une buanderie accolée à la maison, généralement proche du four à pain. Pendant l’utilisation du four, des cendres étaient récupérées puis mises de côté pour être refroidies. Versées dans une petite poche en tissu, elles servaient de poudre lavante. Cette poche était ensuite posée dans un cuvier avec le linge sale sur lequel on versait de l’eau bouillante. Un trou au fond de la cuve permettait de récupérer l’eau qui était à nouveau mise à bouillir puis versée plusieurs fois sur le linge. Après cette étape qui durait plusieurs heures, le linge était récupéré par les lavandières qui se rendaient au lavoir afin d’effectuer la phase de battage et rinçage du linge.
Autrefois, laver le linge au lavoir prenait beaucoup de temps. La première phase de la lessive se déroulait dans une buanderie accolée à la maison, généralement proche du four à pain. Pendant l’utilisation du four, des cendres étaient récupérées puis mises de côté pour être refroidies. Versées dans une petite poche en tissu, elles servaient de poudre lavante. Cette poche était ensuite posée dans un cuvier avec le linge sale sur lequel on versait de l’eau bouillante. Un trou au fond de la cuve permettait de récupérer l’eau qui était à nouveau mise à bouillir puis versée plusieurs fois sur le linge. Après cette étape qui durait plusieurs heures, le linge était récupéré par les lavandières qui se rendaient au lavoir afin d’effectuer la phase de battage et rinçage du linge.
 Agenouillées sur un « garde-genoux », boite en bois dont le fond est tapissé de paille afin d’être plus confortable, elles commencent par le battage à l’aide d’un batteur en bois et d’une brosse en chiendent, avant le rinçage et l’essorage. Un sac de bleu (poudre bleue provenant de l’indigotier) est plongé dans la dernière eau de rinçage pour rendre le linge plus blanc. Le séchage a lieu chez soi, le plus souvent étendu sur des haies environnantes ou sur l’herbe.
Agenouillées sur un « garde-genoux », boite en bois dont le fond est tapissé de paille afin d’être plus confortable, elles commencent par le battage à l’aide d’un batteur en bois et d’une brosse en chiendent, avant le rinçage et l’essorage. Un sac de bleu (poudre bleue provenant de l’indigotier) est plongé dans la dernière eau de rinçage pour rendre le linge plus blanc. Le séchage a lieu chez soi, le plus souvent étendu sur des haies environnantes ou sur l’herbe.
On imagine ces femmes aux mains blêmes et raidies d’onglée pendant les hivers rigoureux. Souvent, le lavoir est éloigné du centre du village. Le long trajet en brouette avec le fardeau du linge prend des allures de calvaire surtout lorsqu’arrivent les rigueurs hivernales.
Le lavoir a un rôle social majeur. Témoin du patrimoine local avec les grands et petits moments de nos villages, il évoque le souvenir d’une époque révolue et rappelle le dur labeur de nos grands-mères. Parfois accompagnées de leurs enfants, les femmes se retrouvent entre elles autour du bassin pour faire et défaire les réputations, arranger des mariages, raconter leurs drames et laisser libre cours au rire et au franc-parler. L’utilisation des lavoirs a été progressivement abandonnée pour laisser place à la machine à laver à partir des années 1950.
 Aujourd’hui, ces constructions ont perdu leur fonction initiale mais peuvent néanmoins rester des lieux de rencontre. Certains sont parfois remplis de terre et de plantes et relégués à la décoration de la commune ; d’autres sont transformés en étape pour les promeneurs. Témoins du passé, quelques-uns sont classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
Aujourd’hui, ces constructions ont perdu leur fonction initiale mais peuvent néanmoins rester des lieux de rencontre. Certains sont parfois remplis de terre et de plantes et relégués à la décoration de la commune ; d’autres sont transformés en étape pour les promeneurs. Témoins du passé, quelques-uns sont classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
« Désormais dans les lavoirs désertés, il n’y a plus que le bruit de l’eau. Elle chantonne sans plus jamais être tressée de voix et de regards. Elle court de bac en bac, limpide et n’entraîne plus de traînées savonneuses. Les petites truitelles de lumière vibrent toujours sur les murs »(1). En tendant l’oreille, il est peut-être encore possible d’entendre les rires des enfants qui, pendant les étés chauds et malgré l’interdiction, se baignaient dans l’eau fraîche du lavoir tout en surveillant l’arrivée éventuelle du garde-champêtre.
Geneviève Forget
(1)« La France des lavoirs » de Christophe Lefébure, édition Privat